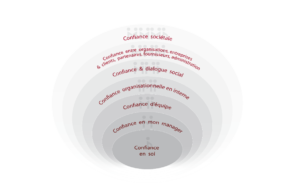LA CONFIANCE, OU COMMENT RASSEMBLER LE TROUPEAU DE CHATS [13/31]. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans un monde férocement individualiste, la confiance pourrait être le socle d’une nouvelle organisation de l’entreprise, voire d’un pays. « La Tribune », en partenariat avec Trust Management Advisors, publie une série d’une trentaine de textes dédiés à la confiance sous ses différentes facettes, sociétale, entrepreneuriale, associant une réflexion de fond et des exemples très concrets issus de cas réels.
- I. La confiance à l’épreuve d’un passé indélébile
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses constituent ce principe spirituel. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs. L’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. » Cette définition que donne Ernest Renan de la nation résonne singulièrement avec nos propres travaux sur la façon dont les sociétés se cimentent autour d’un pacte social tacite. Matrice des comportements collectifs et socle de la confiance, ce pacte social connecte, lui aussi, le présent aux réminiscences du passé. En invitant à envisager l’histoire des peuples sur la longue durée, il constitue un prisme original, et souvent révélateur, à l’image de l’éclairage qu’il porte sur les relations franco-allemandes.
Le « legs de souvenirs » de Renan, ce sont les traces laissées par l’histoire dans notre mémoire collective. Peu importe que la réalité ait été déformée, amplifiée, altérée par les événements ultérieurs ou corrompue par la culture populaire ; ce qui compte ce ne sont pas tant les faits que ce qu’il en reste, car c’est cela que les peuples ont en commun et qui les fait agir et réagir «comme un seul homme». Dans le cas des nations de la « vieille Europe », cette subconscience historique remonte fort loin. Pour la France et l’Allemagne, tout commence il y a très exactement quatre siècles avec le déclenchement de la guerre de Trente ans, en 1618. Jusqu’alors, les deux anciens frères carolingiens, séparés au traité de Verdun, avaient suivi des trajectoires divergentes. Dès l’an mille, la France capétienne était entrée dans la logique monolithique et centralisatrice qui prévaut encore aujourd’hui, tandis que l’Allemagne demeurait fragmentée et enfouie dans une construction beaucoup plus vaste d’essence impériale.
Dès la fin des années 1620, exploitant ce morcellement et les tensions religieuses qui l’accompagnent, Richelieu attise les querelles intestines pour saper la puissance des Habsbourg. Par la suite, cette politique d’ingérence déstabilisatrice sera poursuivie de façon plus ou moins belliqueuse, mais avec constance, jusqu’à Napoléon. Héraut de la bonne parole révolutionnaire, ce dernier porte en 1806 le coup de grâce au Saint-Empire quasi-millénaire en créant la confédération du Rhin. Cette même année, sur son ordre, Johann Philipp Palm est exécuté pour avoir publié un pamphlet au titre évocateur : L’Allemagne et son humiliation profonde. Au bout de deux siècles d’immixtion dans leurs affaires intérieures, les Allemands vouent aux Français une haine absolue. « Il fallait haïr les Français pour ce qu’ils avaient fait aux Allemands non seulement au cours des vingt dernières années, mais depuis plus de trois siècles », écrit le poète Ernst Moritz Arndt en 1813. De cette détestation viscérale, il reste aujourd’hui encore l’image d’une France arrogante et envahissante, la « Grande Nation » dont l’image de Napoléon semble vouée à caricaturer à jamais les ambitions universalistes.
Dans cette « haine sanglante du Français », théorisée par le père de l’éducation physique Friedrich Ludwig Jahn, les Allemands trouvent cependant le catalyseur qui avait jusqu’alors toujours manqué à leur union. Symboliquement, c’est sa victoire sur l’Erbfeind, l’« ennemi héréditaire », qui permet à Bismarck de fonder l’Empire allemand en 1871. Pour les Français, à la douleur de la défaite s’ajoute l’affront de voir les Allemands consacrer la naissance de leur État à Versailles, dans la galerie des Glaces. Dès lors, le revanchisme devient l’un des piliers de la Troisième République. Institutionnalisé jusque dans les salles de classe, le ressentiment germanophobe est si profondément gravé dans l’âme des Français qu’ils conservent durablement de leurs voisins l’image d’un peuple ambitieux, brutal et dominateur, oubliant au passage qu’ils ne valent guère mieux à leurs yeux.
Bien entendu, la suite immédiate de l’histoire n’a pas contribué à les détromper. Pourtant en position de force après 1870, l’Allemagne n’est pas parvenue à accomplir ses rêves de grandeur que Jahn prophétisait ainsi dès 1810 : « Si, unie avec elle-même sous la forme d’une communauté allemande, l’Allemagne déploie ses forces immenses encore inemployées, elle pourra être un jour celle qui fondera la paix éternelle en Europe, ange gardien de l’humanité. » Au contraire, après l’humiliant coup d’arrêt que fut pour elle l’amère défaite de 1918, elle choisit pour ses ambitions la voie la plus funeste.
Au regard de cette longue et douloureuse histoire, la paix que connaissent la France et l’Allemagne depuis soixante-quinze ans n’est pas un mince miracle. Mais soixante-quinze ans, soit trois générations, ne peuvent suffire à effacer des préjugés recuits durant des siècles. Même si les choses ont – fort heureusement – considérablement évolué, il fut un temps pas si lointain où détester le voisin d’outre-Rhin faisait partie du Contrat invisible national : on n’était pas un « bon Allemand », ou un « bon Français », si l’on n’avait pas cette exécration chevillée au cœur. Que nous le voulions ou non, ce « legs de souvenirs » nous conditionne presque à notre insu et, en dépit des progrès, il ne saurait être question d’avenir et de confiance partagés si nous occultons ce passé.
- II. De la confiance contrainte à la confiance positive
En 1945, en dépit des apparences, la France et l’Allemagne sont dans le même camp : celui des perdants. Malgré son strapontin arraché à la table des Grands, la France est un pays déclassé, une puissance de second rang ravalée dans son prestige. Quant à l’Allemagne, en ruines et bientôt coupée en deux, elle est durablement marquée du sceau de l’infamie. Pourtant, le traumatisme n’a pas totalement effacé leurs aspirations séculaires et la persistance de ces vieux rêves, inscrits dans l’âme des peuples, explique pour beaucoup la trajectoire de la relation franco-allemande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Face aux périls d’une reconstruction dans un monde sur lequel ils n’ont plus prise et à la perspective de n’être que des pions sur l’échiquier de la Guerre froide, Français et Allemands prennent la décision ferme de se rapprocher et de s’y tenir. Se soutenant l’un l’autre, les deux pays s’engagent ensemble sur le chemin de la construction européenne, seule voie possible vers la prospérité et la paix. Mort-né pour De Gaulle en raison des concessions de dernière minute du Bundestag aux Américains, le traité de l’Élysée deviendra, grâce à Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt, le moteur du projet européen. Leur lecture de ce document historique constituera un modèle pour leurs successeurs, François Mitterrand et Helmut Kohl. Grâce à eux, la confiance contrainte des perdants devient une confiance positive et constructive, qui engendre un nouveau « legs de souvenirs » commun.
Mais, en 1989, l’équilibre est bouleversé. Le pacte social des nations se cristallise à la faveur de grandes épreuves ou de grands bouleversements populaires. Or, si la France a incontestablement connu de tels moments fondateurs, 1789 en tête, l’Allemagne-nation attend toujours cette épiphanie. Et ce manque n’a cessé d’alimenter le rêve formulé dès 1810 par Friedrich Ludwig Jahn : quand, enfin, l’Allemagne sera parvenue à unir ses forces, alors elle accomplira l’œuvre grandiose à laquelle la destine manifestement son potentiel. Avec la chute du mur de Berlin, lui est enfin donnée l’occasion de renouer avec cette éternelle aspiration.
Jusqu’alors, l’Allemagne avait surtout cherché à expier sa faute en s’attachant, selon le mot de Willy Brandt, à être un « bon voisin », discret, travailleur et dévoué à la cause européenne. Mais la réunification et le dégel de l’Europe orientale lui offrent l’opportunité de mettre ses forces retrouvées au service de son propre dessein : désormais, l’Allemagne conquerra sa place au premier rang des nations non par la force, mais en étant pour le monde un modèle de vertu. Cette haute aspiration morale, voire moralisatrice, éclaire quelques-unes des grandes décisions récentes d’Angela Merkel, qu’il s’agisse de la sortie précipitée du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, de l’accueil massif des migrants ou du durcissement récent des conditions d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite. Mais on ne saurait trahir son pacte national et le sentiment enfoui d’être un peuple d’exception ne manque pas de ressurgir, comme lorsque Volker Kauder, chef du groupe conservateur au Bundestag, déclare en 2011 que «désormais, l’Europe parle Allemand», ou quand Volkswagen choisit pour slogan « Das Auto » – en appuyant bien sur le D au cas où l’on n’aurait pas compris -, sans mesurer ce que cette formule lapidaire peut avoir de violent et caricatural pour le monde.
Quant à la France, elle non plus n’a pas renoncé à sa vocation de toujours d’éclairer le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, consciente de n’en avoir plus les moyens seule, elle a fait de l’Europe le véhicule de cette ambition. Pour les Français, du premier au dernier d’entre eux, c’est une évidence : l’Union européenne ne peut être qu’une grande France, sociale et égalitaire. Malheureusement, le pays croit de moins en moins en sa capacité de faire triompher cette vision. En pleine crise de confiance, il constate avec dépit qu’il n’a plus les phares intellectuels, artistiques ou technologiques qui faisaient encore récemment sa fierté, et qu’il peine de plus en plus à rallier ses partenaires à ses vues dont il demeure, pourtant, convaincu de la justesse.
Ainsi, après avoir été une planche de salut partagée et l’instrument d’un spectaculaire redressement pacifique, l’Europe est devenue le révélateur que les rêves profondément ancrés dans les psychés nationales françaises et allemandes, tout en se respectant, ne se renforcent plus mutuellement. Les dissonances de ces aspirations, et le non-dit assourdissant qui les entoure, sont aujourd’hui ce qui grippe le partenariat franco-allemand. Pour retrouver la confiance nécessaire à une dynamique d’avenir, il est grand temps pour les deux pays de regarder avec lucidité et franchise tant leurs divergences héréditaires que leurs intérêts communs.
- III. Inventer une nouvelle confiance pour un nouveau siècle
Y-a-t-il lieu de poursuivre et de renforcer le partenariat franco-allemand ? Pour iconoclaste qu’elle soit, cette question mérite d’être posée étant donné la distance manifestée par l’Allemagne envers la France depuis maintenant de longues années. Et, hormis la nécessité occasionnelle de présenter un front uni face aux menaces extérieures, la réponse, du point de vue des élites allemandes, semble bel et bien être non.
À de nombreux égards, l’Allemagne considère ne plus avoir besoin de la France et elle s’autorise déjà à se passer d’elle. Lorsqu’elle décide brutalement d’abandonner le nucléaire ou d’ouvrir en grand ses portes aux migrants, elle néglige ainsi de la consulter en dépit des inévitables répercussions qu’auront de telles décisions sur ses voisins et sur l’Europe en général. Depuis la chute du mur de Berlin, comme nous l’avons vu, l’Allemagne entend accomplir seule son destin et ne plus prêter son concours à la vision française de l’Europe. Sans compter que voir la France empêtrée dans les difficultés de sa mutation lui offre une excuse idéale.
Mais l’Allemagne imagine-t-elle réellement pouvoir rivaliser seule avec la Chine, les États-Unis ou l’Inde ? À moins de se laisser enivrer par sa réussite économique ou aveugler par une sorte de présomption identitaire, elle ne peut nier les fragilités qui obèrent son futur : sa faiblesse démographique endémique, des inégalités sociales et territoriales qui ne cessent de se creuser, mais aussi les limites de son modèle économique lui-même. Les pays de l’Est ne resteront pas éternellement son atelier à bas coût et lorsque le monde se sera équipé de ses machines-outils, les biens manufacturés feront en masse le chemin en sens inverse. En réalité, la puissance allemande est tissée de fragilités et, ainsi que ne cesse de le répéter la France, seule une Europe unie est capable de tenir tête au reste du monde. Par Europe unie, on entend bien sûr toute l’Europe et non quelque club étriqué de pays du nord, convaincus de leur supériorité et rassemblés autour de l’Allemagne, idée absurde dont la rumeur reparaît pourtant régulièrement. Aussi, plus encore maintenant qu’ils sont délestés des Britanniques, Français et Allemands n’ont d’autre choix que de renforcer leur coopération. Et pourtant, c’est tout le contraire qui se fait sous nos yeux
Soyons lucides : aujourd’hui, le partenariat franco-allemand est dysfonctionnel pour des raisons culturelles profondes que les nécessités de l’après-guerre ne masquent plus. Dans leur ADN social, Français et Allemands portent en eux des aspirations qui ne se renforcent plus mutuellement. Bien que doutant d’eux-mêmes, les Français ne désespèrent pas de convaincre le monde des bienfaits de leur idéal égalitaire issu des Lumières. Quant aux Allemands, ils cherchent à accomplir par la vertu le destin exemplaire auquel ils s’estiment voués, ce que la montée de l’AfD remet fondamentalement en cause. Pour refonder la coopération entre les deux pays, il apparaît donc indispensable non seulement de reconnaître cette discordance fondamentale (qui n’est en rien hostile), mais aussi de parvenir à établir un climat de confiance d’un nouveau genre qui permettra de s’en accommoder et de la transcender.
Cependant, à l’ère du troupeau de chats, où la multiplicité des aspirations individuelles ébranle toute forme de collectif et disloque les liens sociaux traditionnels, la confiance ne s’impose ni ne se décrète. Ce n’est plus un éther implicite dans lequel baigne la relation, mais une matière dense et palpable qui se mesure, se travaille et se développe.
De plus, comme l’a démontré la sociologue Bénédicte Zimmermann, la confiance se fabrique différemment en France et en Allemagne. En France, elle est processuelle, c’est-à-dire qu’elle doit être constamment entretenue par des gages mutuels de bonne foi. Sans cela, les liens se distendent et la confiance s’estompe. D’une certaine façon, cette exigence relationnelle correspond aux évolutions sociétales actuelles, qui contribuent même à la renforcer. En Allemagne, en revanche, la confiance est instituée : elle procède d’organisations, de règles, d’habitudes extérieures et indépendantes des personnes. Dans ce cadre, la confiance va de soi et dure tant que rien ne vient la remettre en cause. Gage de stabilité et de discipline, cette foi dans les structures – et ceux qui les incarne – a longtemps servi l’économie allemande, mais elle apparaît aujourd’hui en décalage avec la montée de l’individualisme contemporain.
Face aux périls annoncés de ce siècle, le statu quo n’est pas envisageable. Projetons la France et l’Allemagne, qui ne sont pas toute l’Europe mais sans qui l’Europe n’est rien, dans vingt ans : les deux pays seront peuplés chacun de 70 à 75 millions d’habitants dans une Europe qui en comptera 450, environnée d’une Chine de 1,3 milliard d’habitants qui usera sans complexe de sa position de première puissance mondiale, et d’une Afrique en route vers les 2 milliards d’habitants qui, si elle ne stabilise pas d’ici là son économie, sera l’épicentre d’une crise migratoire sans commune mesure avec celle que nous connaissons aujourd’hui. Ces évidences démographiques et géopolitiques suffisent pour comprendre que la France et l’Allemagne se doivent absolument de relancer la construction européenne, d’entraîner après eux l’ensemble de leurs voisins dans toute leur admirable diversité et, pour cela de renforcer leur partenariat en s’appuyant sur cette confiance explicite et construite.
Dans cette nouvelle confiance, qui n’est plus faite de politesses et d’évitement, mais de dialogue profond, de lucidité et d’action, il n’y a plus de place pour les faux-fuyants émotionnels, et la France doit en finir avec son antienne infondée et improductive de « couple » franco-allemand. Mais il n’y a pas non plus de place pour les tabous, et l’Allemagne doit reconnaître, et assumer, que son passé ne sera jamais oublié. Enfin, cette confiance nouvelle se nourrit de concret et les deux pays doivent multiplier les projets qui donneront de la chair à leur partenariat. Tout ceci n’a rien d’utopique. Pour reprendre le mot de Renan, la France et l’Allemagne restent sur soixante-quinze ans d’un « legs de souvenirs » à nul autre pareil. L’inimaginable réconciliation de ces deux ennemis jurés demeure un exemple pour le monde. Et il n’est sans doute pas de plus belle fondation pour bâtir l’avenir.
___
LES AUTEURS
Jean-Luc FALLOU (Insead, École des Mines) est le président de Trust Management Advisors-Stratorg depuis 1998, il est également le président-fondateur de Trust Management Institute.